Par Charlotte Arce et Elsa Pereira
Elles ont la vingtaine, ont grandi avec #MeToo et se définissent comme « intersectionnelles », « radicales », « vénères ». Rencontre avec la nouvelle génération de féministes, qui renouvelle les codes du militantisme et ouvre le champ des combats.
« Je crois que mon engagement féministe est né au collège, où je me suis très vite rendu compte qu’en tant que fille, qui plus est noire, je n’avais pas les mêmes droits. J’étais hypersexualisée, et en même temps je me prenais des remarques sur la couleur de ma peau. Ça m’a très vite énervée et révoltée. »
Aujourd’hui, Lauren Lolo a 23 ans et se dit toujours « vénère« . Contre le sexisme, le racisme, le validisme, le classisme. Étudiante en sciences politiques, elle a fait de la lutte contre ces oppressions son combat, forgeant sa conscience afro-féministe sur Internet grâce aux blogs, où elle s’est abreuvée pendant des années des réflexions de militantes chevronnées, avant de faire elle aussi entendre sa voix, sur le web puis dans l’espace public.
Co-fondatrice et directrice générale de l’association Cité des chances, qui intervient auprès des jeunes de banlieue pour les sensibiliser à la vie politique et citoyenne, elle fait partie de cette génération de féministes qui a grandi avec les réseaux sociaux et revendique fièrement sa prise de parole. « Ce qui me motive beaucoup, c’est d’être tout ce que je suis : une femme, jeune, noire, qui vient de banlieue, porteuse d’un handicap invisible (une opération l’a laissée paralysée des membres inférieurs en 2014, ndlr). Toutes ces oppressions sont pour moi des forces, et j’ai envie que ces questions soient prises en compte dans le débat public. »
Lycéennes et lanceuses d’alerte
À l’image de Lauren Lolo, les féministes vingtenaires sont devenues des lanceuses d’alerte, portant des combats qui touchent leur génération pour leur donner une dimension à la fois inclusive et universelle. « Je suis très admirative de cette nouvelle génération de féministes« , commente Chloé Thibaud, journaliste et rédactrice en chef de la newsletter Les Petites Glo, destinée aux moins de 25 ans. « Les adolescentes d’aujourd’hui me semblent bien plus engagé·e·s que ma génération ne l’était. Dès 12 ans, des filles se battent pour faire installer des distributeurs de protections périodiques gratuits dans leur établissement scolaire, c’est remarquable. Je n’ai que 30 ans, mais cet écart d’âge me permet déjà de mesurer les progrès que nous avons faits« , poursuit-elle.
Preuve que la portée des combats ne se mesure pas à l’âge des militantes, le mouvement #Lundi14Septembre, lancé à l’automne 2020 par des filles n’ayant pas encore le droit de voter, mais déjà vent debout contre le double standard sexiste qu’elles subissent au sein de leur établissement scolaire. Interdit·e·s de porter des jupes ou des crop-top jugés « provocants » et susceptibles de « déconcentrer leurs camarades masculins », collégien·ne·s et lycéen·ne·s se sont en effet mobilisé·e·s en masse à la rentrée pour revendiquer le droit de s’habiller comme ils·elles l’entendent, sans être vu·e·s comme des objets sexuels.
Grandir avec #MeToo
Non seulement consciente des injustices et du contrôle social qui s’exercent sur les corps féminins, la nouvelle génération de féministes a aussi compris dès l’adolescence l’importance de prendre la parole pour faire bouger les lignes. « Les jeunes ont compris qu’il ne fallait pas – plus – se taire. C’est une génération qui a grandi avec le mouvement #MeToo et qui a en tête cette phrase : ‘la parole se libère’. Cette idée est vraiment très précieuse : cela ne signifie pas que les générations précédentes ne l’avaient pas comprise, mais que celle-ci a la volonté de faire tomber un à un tous les tabous. De ne rien laisser sous silence« , analyse Chloé Thibaud.
En 2018, un sondage Harris Interactive pour le feu hebdomadaire Vraiment soulignait déjà la portée de #MeToo sur les 25-34 ans : alors qu’en 2014, seule une jeune femme sur deux (53 %) se considérait féministe, elles étaient 76 % à la revendiquer il y a trois ans. Combien aujourd’hui ? Certainement davantage. Il n’y a qu’à voir la portée de leurs revendications sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue ou les médias. Le 8 février dernier, le mouvement #SciencesPorcs dépassait les frontières d’Instagram et de Twitter en mettant en lumière les agressions sexuelles et viols commis en toute impunité dans les instituts d’études politiques (IEP). Lancé par « l’influenceuse féministe » de 25 ans Anna Toumazoff, le hashtag a engendré des milliers d’occurrences sur Twitter et mené à l’ouverture de deux enquêtes préliminaires à Toulouse et Grenoble.
La lutte contre la culture du viol est au cœur du militantisme des jeunes féministes. « On a toutes subi des choses, on est légitimes dans notre colère« , témoigne ainsi Shanley McLaren, 22 ans, dans le documentaire « Génération Brut ». Étudiante en sciences politiques à l’université Paris 8, elle s’était faite connaître en 2017 pour avoir initié le blocus de son lycée dans le Val-d’Oise pour dénoncer le harcèlement sexuel que subissaient certaines élèves. Aujourd’hui, elle milite au sein de StopFisha, un collectif qui traque les comptes « fisha » (« affiche » en verlan), qui diffusent sur Telegram et Instagram des « nudes » de jeunes filles, souvent mineures, sans leur consentement. « Dans la lutte féministe, tu fais aussi tomber des têtes. Il faut pointer du doigt le problème : dire ‘ça c’est problématique’, ‘lui c’est un agresseur’. Et si le système judiciaire ne le punit pas, c’est à nous de former des collectifs, s’unir pour le dénoncer et en faire quelque chose. L’impunité, ça va deux secondes« , explique Shanley.
S’il faut en finir avec l’impunité des anonymes sur Internet, il faut aussi dénoncer celles des hommes de pouvoir et réclamer un changement profond du système qui leur profite. C’est ce que fait l’association de Sciences-Po Paris Chafia, qui a co-signé une tribune en janvier dans Libération pour réclamer la démission de Frédéric Mion à la tête de l’IEP. Ce dernier est accusé d’avoir maintenu à son poste Olivier Duhamel après avoir eu connaissance des accusations d’agressions sexuelles et de viols incestueux portées à son encontre. Il a fini par démissionner le 11 février. « C’est une victoire importante et un message fort. Mais cela ne s’arrête pas là, il reste beaucoup de travail à faire et de revendications à porter« , souligne Shanese Rivera, 20 ans et co-fondatrice de Chafia.
« S’il n’est pas intersectionnel, ce n’est pas du féminisme, mais de la suprématie blanche en rose »
Étudiante à Sciences-Po Paris, Shanese est aussi engagée contre les violences faites aux femmes. Un combat porté à l’échelle nationale par des associations et collectifs comme Nous Toutes, et dont s’emparent les jeunes militantes, pour lui donner une dimension plus inclusive. « Ce qui est extrêmement important, c’est la libération de toutes les femmes« , note Shanese qui, en tant que jeune femme racisée, explique subir le sexisme et le racisme « en même temps ».
D’où la nécessité de prôner un féminisme intersectionnel, qui prend en compte l’ensemble des oppressions vécues par les personnes racisées, handicapées, grosses ou encore appartenant à la communauté LGBTQIA+. « Je crois que ce qui me met le plus en colère, c’est la négation des réalités vécues par certaines femmes/personnes, mais aussi la dépolitisation de nos luttes, développe Shanese. En tant que femme racisée, j’en ai assez de voir des femmes ou des hommes parler en mon nom. »
« S’il n’est pas intersectionnel, ce n’est pas du féminisme, c’est de la suprématie blanche en rose, lâche Lauren Lolo. Que ce soit en tant que noir·e·s, en tant que porteur·se·s de handicap, en tant que jeunes, en tant que femmes, on ne nous inclut pas dans les scénarios possibles. Les hommes, les décideurs, ne se posent pas vraiment la question de la façon dont on va recevoir leurs lois. C’est très énervant de constater qu’ils nous oublient. Mais ça me motive aussi à continuer la lutte et à ne rien lâcher. »
« Il y a chez cette nouvelle génération une intransigeance qui me fascine, reconnaît Chloé Thibaud. Le refus de toute forme de discrimination et de les hiérarchiser, l’envie de donner la parole à tout le monde, surtout à celles et ceux qui ne l’ont jamais eue – ou pas assez – me semble un phénomène systématique sinon nouveau, au moins récent. »
Retrouvez Qui sont les féministes de la génération Z ? Partie II, le samedi 20 mars dans votre boîte mail
Abonnez-vous et recevez chaque samedi notre newsletter féministe et participative
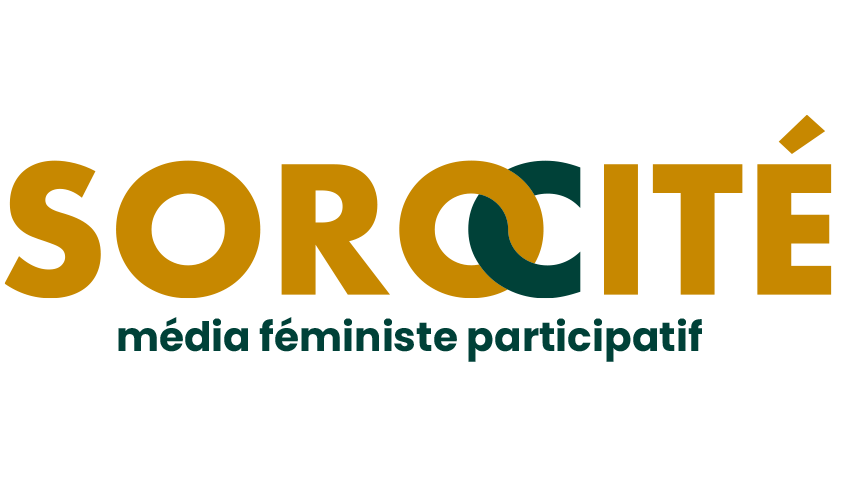

Hello, merci pour ce beau post.
Pourrais-je en savoir un peu plus sur ce qu’est le mouvement #MeToo?
J’aimeJ’aime