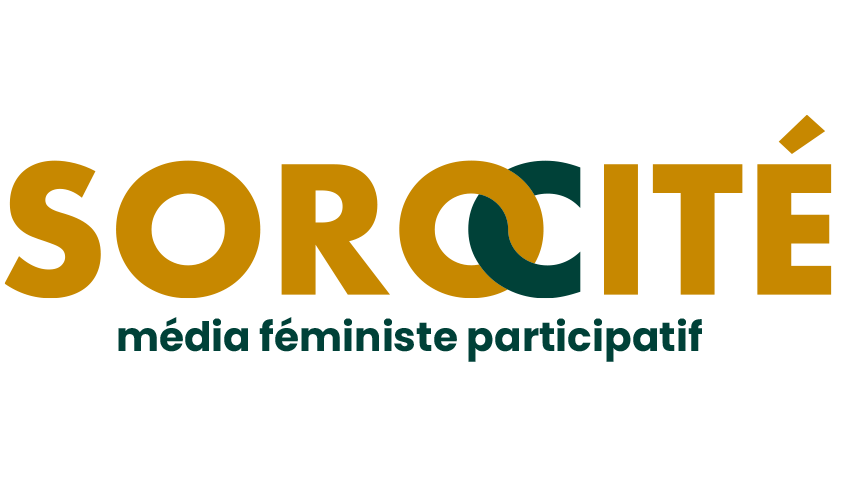Par Elsa Pereira
Des rivières de sang, des contractions qui ébranlent de la tête aux pieds, le sentiment qu’on ne vaut rien… Rares sont les films, les séries, les romans qui racontent l’après-accouchement dans sa réalité, comme un moment parfois violent et souvent plus long qu’on ne le croit. Dans l’imaginaire collectif, le bébé irradie la photographie, on ne voit que lui·elle et son sourire de nouveau·elle né·e. Mais la réalité peut être toute autre.
Parfois, la mère étouffe ses cris, sanglote en silence et se cache pour taire son mal-être. Incapable de panser seule ses plaies, ni même de les comprendre, elle ronge son désespoir en attendant des jours meilleurs. Le monde s’est écroulé et personne ne l’a préparée pour la suite. Évidemment, tous les post-partum ne se ressemblent pas. Certains se déroulent même très bien. Mais taire qu’il existe des lendemains difficiles, c’est mettre les femmes sur le champ de bataille sans arme, ni bouclier. C’est les exposer au pire.
« Parce que le savoir, c’est le pouvoir », la sociologue Illana Weizman a décidé de lever le voile sur l’un des plus gros tabous de la maternité. Dans son ouvrage Ceci est notre post-partum, paru en janvier 2021 aux éditions Marabout, la co-créatrice du mouvement #MonPostPartum redonne du sens aux vécus de femmes, abandonnées dans leur dépression. Rencontre.
Sorocité : Pourquoi le post-partum est-il un si grand tabou ?  Illana Weizman : Convalescence à la fois physique et mentale, le post-partum entre en contradiction avec ce que l’inconscient collectif dit de la maternité. Dans un système patriarcal, le rôle assigné aux femmes, c’est la maternité. C’est le rôle ultime, il ne « faut » surtout pas parler de ce qui pourrait dissuader, faire peur ou tout simplement aller à l’encontre de cette image-là. On parle ici du post-partum, mais c’est aussi le cas de la fausse-couche, de la PMA et de tout ce qui va altérer l’image d’une maternité « naturelle », « fluide » et « simple ». Tout ce vécu doit rester en coulisse, bien caché. Or, le corps post-partum correspond rarement aux injonctions patriarcales : il ressemble à un corps vieillissant, un peu affaissé, encore marqué par des vergetures, voire chaotique quand des fluides s’en évacuent. C’est un corps en transition qu’on préfère invisibiliser, parce qu’il ne correspond pas à ce que l’on attend d’une femme. Le problème, c’est que quand on va se voir dans le miroir, on ne va pas savoir à quoi se raccrocher. On n’a pas vu de corps comme celui-là avant, ni dans les films, ni dans des publicités. Illana Weizman : Convalescence à la fois physique et mentale, le post-partum entre en contradiction avec ce que l’inconscient collectif dit de la maternité. Dans un système patriarcal, le rôle assigné aux femmes, c’est la maternité. C’est le rôle ultime, il ne « faut » surtout pas parler de ce qui pourrait dissuader, faire peur ou tout simplement aller à l’encontre de cette image-là. On parle ici du post-partum, mais c’est aussi le cas de la fausse-couche, de la PMA et de tout ce qui va altérer l’image d’une maternité « naturelle », « fluide » et « simple ». Tout ce vécu doit rester en coulisse, bien caché. Or, le corps post-partum correspond rarement aux injonctions patriarcales : il ressemble à un corps vieillissant, un peu affaissé, encore marqué par des vergetures, voire chaotique quand des fluides s’en évacuent. C’est un corps en transition qu’on préfère invisibiliser, parce qu’il ne correspond pas à ce que l’on attend d’une femme. Le problème, c’est que quand on va se voir dans le miroir, on ne va pas savoir à quoi se raccrocher. On n’a pas vu de corps comme celui-là avant, ni dans les films, ni dans des publicités.C’est d’ailleurs la censure d’une publicité qui est à l’origine de votre colère et du mouvement #MonPostPartum…  Lorsque j’ai vu la censure de cette publicité aux Oscars 2020, je sortais à peine la tête de l’eau, après une année de dépression. Et là, je me suis dit que c’était en grande partie à cause de ça que j’avais si mal vécu mon post-partum. Je n’avais rien à quoi me raccrocher, je me suis sentie très isolée, très défaillante. C’est terrible de vivre une expérience et de s’en sentir complètement dépossédée, parce qu’il n’y a pas de représentation. C’est un moment de grande solitude. En regardant cette publicité, j’ai réalisé que c’était la première fois que je voyais un corps post-partum avec le ventre encore arrondi, avec une linea nigra (ndlr : une ligne sombre qui va du pubis au sternum). Je me suis reconnue, j’ai reconnu le corps que j’avais. J’étais en colère que l’on censure ça, c’était vraiment loin d’être gore. J’ai réalisé que pour la société, peu importe la manière dont est représenté le post-partum, ce ne sont pas les images qui sont problématiques, mais le simple fait d’en parler. Lorsque j’ai vu la censure de cette publicité aux Oscars 2020, je sortais à peine la tête de l’eau, après une année de dépression. Et là, je me suis dit que c’était en grande partie à cause de ça que j’avais si mal vécu mon post-partum. Je n’avais rien à quoi me raccrocher, je me suis sentie très isolée, très défaillante. C’est terrible de vivre une expérience et de s’en sentir complètement dépossédée, parce qu’il n’y a pas de représentation. C’est un moment de grande solitude. En regardant cette publicité, j’ai réalisé que c’était la première fois que je voyais un corps post-partum avec le ventre encore arrondi, avec une linea nigra (ndlr : une ligne sombre qui va du pubis au sternum). Je me suis reconnue, j’ai reconnu le corps que j’avais. J’étais en colère que l’on censure ça, c’était vraiment loin d’être gore. J’ai réalisé que pour la société, peu importe la manière dont est représenté le post-partum, ce ne sont pas les images qui sont problématiques, mais le simple fait d’en parler. Qu’est-ce que vous avez voulu dire et transmettre avec Ceci est notre post-partum ?  En France, ce n’est que depuis 2017 que l’on trouve des livres ou des podcasts qui traitent du sujet, mais ils abordent la question avec un angle plus individuel : comment se remettre, comment bien manger, etc. J’ai voulu faire quelque chose de plus politique, prendre de la distance. Le problème n’est pas individuel, il est systémique. On est dans une culture qui sacrifie les mères sur l’autel de la maternité et qui les laisse à l’abandon. Puisque personne n’en parle, on pense que c’est nous le problème, que l’on n’est pas assez fortes. Je voulais prendre un recul analytique et c’est pour cette raison que le livre démarre sur les tabous civilisationnels autour de l’histoire du post-partum. J’ai ensuite voulu explorer des solutions pour faire évoluer les choses sur le plan collectif. En France, ce n’est que depuis 2017 que l’on trouve des livres ou des podcasts qui traitent du sujet, mais ils abordent la question avec un angle plus individuel : comment se remettre, comment bien manger, etc. J’ai voulu faire quelque chose de plus politique, prendre de la distance. Le problème n’est pas individuel, il est systémique. On est dans une culture qui sacrifie les mères sur l’autel de la maternité et qui les laisse à l’abandon. Puisque personne n’en parle, on pense que c’est nous le problème, que l’on n’est pas assez fortes. Je voulais prendre un recul analytique et c’est pour cette raison que le livre démarre sur les tabous civilisationnels autour de l’histoire du post-partum. J’ai ensuite voulu explorer des solutions pour faire évoluer les choses sur le plan collectif.Selon vous, pourquoi le mouvement #MonPostPartum a pris aussi vite ?  Il y a assurément un effet post-#MeToo. On le voit en ce moment avec #MetooInceste. Avant, le silence était tellement fort que la prise de parole en ligne agit comme une déflagration. Mais cette parole doit aussi sortir des réseaux, il faut que ça se propage, le hashtag n’est qu’une première étape. Il faut transformer l’essai en mettant en avant des pistes politiques. Dans la sphère militante, on a l’impression que ça progresse vite, mais quand on voit les commentaires postés sous les vidéos, on se rend vite compte qu’il y a encore beaucoup de résistance face à la volonté de briser ces tabous. Il y a assurément un effet post-#MeToo. On le voit en ce moment avec #MetooInceste. Avant, le silence était tellement fort que la prise de parole en ligne agit comme une déflagration. Mais cette parole doit aussi sortir des réseaux, il faut que ça se propage, le hashtag n’est qu’une première étape. Il faut transformer l’essai en mettant en avant des pistes politiques. Dans la sphère militante, on a l’impression que ça progresse vite, mais quand on voit les commentaires postés sous les vidéos, on se rend vite compte qu’il y a encore beaucoup de résistance face à la volonté de briser ces tabous.Comment se défaire de ces tabous liés à la domination masculine ?  Essayer, quand on vit ces souffrances, d’en parler autour de soi. Je ne dis pas que c’est évident, parce que souvent on ne nous écoute pas, on nous remet vite sur le droit chemin en nous disant « oui c’est dur, mais ça passe » ou encore « regarde ton enfant, il est en bonne santé ». Toutes ces petites phrases qui visent surtout à nous faire taire. Mais plus on prend la parole sur nos difficultés, plus on les normalise. Et plus ce sera entendu, plus ce sera entendable. Essayer, quand on vit ces souffrances, d’en parler autour de soi. Je ne dis pas que c’est évident, parce que souvent on ne nous écoute pas, on nous remet vite sur le droit chemin en nous disant « oui c’est dur, mais ça passe » ou encore « regarde ton enfant, il est en bonne santé ». Toutes ces petites phrases qui visent surtout à nous faire taire. Mais plus on prend la parole sur nos difficultés, plus on les normalise. Et plus ce sera entendu, plus ce sera entendable. On ne sortira jamais vraiment de ce système dans lequel on nous fait croire que la maternité rime avec sacrifice. Souffrir en maternité, c’est « tellement normal » que cela devient une identité. Souffrir pour être belle, souffrir pour être mère. La condition de la femme, c’est une condition de souffrance. C’est le travail de la domination masculine de nous faire croire que c’est normal de vivre ça et qu’en plus, il faudrait taire cette douleur. Pourquoi est-ce si compliqué, aujourd’hui encore, de parler de dépression post-partum, y compris entre femmes ?  Parler de ses difficultés, c’est transgresser. Avouer qu’on se cache dans les toilettes pour pleurer, c’est montrer que l’on n’est pas la mère que l’on « devrait » être. Quand on réalise qu’on ne répond à ces codes, on se dit qu’on est une mauvaise mère, qu’individuellement on a un souci. C’est très dur d’en parler aux autres, parce que ce serait avouer au reste du monde qu’on est défaillante d’autant plus qu’il y a une forme de compétition maternelle qui s’installe. C’est comme ça que le système de domination fonctionne, parce qu’il est incorporé par ses victimes, qui s’en font les relais. Si on ne participait pas à notre propre aliénation, le système serait démonté… demain matin ! Parler de ses difficultés, c’est transgresser. Avouer qu’on se cache dans les toilettes pour pleurer, c’est montrer que l’on n’est pas la mère que l’on « devrait » être. Quand on réalise qu’on ne répond à ces codes, on se dit qu’on est une mauvaise mère, qu’individuellement on a un souci. C’est très dur d’en parler aux autres, parce que ce serait avouer au reste du monde qu’on est défaillante d’autant plus qu’il y a une forme de compétition maternelle qui s’installe. C’est comme ça que le système de domination fonctionne, parce qu’il est incorporé par ses victimes, qui s’en font les relais. Si on ne participait pas à notre propre aliénation, le système serait démonté… demain matin ! |
 Ceci est notre post-partum, défaire les mythes et les tabous pour s’émanciper d’Illana Weizman Éd. Marabout. |
Abonnez-vous et recevez chaque samedi notre newsletter féministe et participative